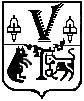
ERS la fin de Juillet 1914, une auto de luxe, une Mercédès longue et fine, montant au col, tomba en panne devant l'auberge. Quatre hommes, très grands, blonds et tondus très ras, la figure balafrée de cicatrices sautèrent sur la route, jetant à droite et à gauche des regards inquiets. En hâte ils réparèrent, échangeant quelques rares observations dans une langue gutturale et rauque.
Phine, poliment, s'approcha, leur proposant de se reposer, de se rafraîchir, de déjeuner : elle avait des truites, de l'isard. Ils déclinèrent sèchement sa proposition. L'un d'eux cependant, lui demanda dans un français très pur et sans accent : — Pardon, Madame, combien y a-t-il de kilomètres d'ici au col ?
— Six, Monsieur.
— La route est-elle plus mauvaise ?
— Non, Monsieur
— Je vous remercie.
Ils jetèrent les outils pêle-mêle dans la boîte sans les ranger, puis celle-ci, sur un siège arrière. Avant même que les portières aient claqué, le conducteur démarra brutalement et la voiture, comme arrachée du sol, partit à toute allure.
Phine, intriguée, essaya de lire le numéro : il disparaissait sous une couche épaisse de poussière et de cambouis.
Le lendemain et le surlendemain, ce fut un défilé incessant d'autos et d'attelages de toutes sortes, l'exode des familles espagnoles en villégiature aux Eaux-Bonnes qui s'empressaient de rentrer dans leur pays avant la déclaration imminente de la guerre et la fermeture de toutes les frontières qui en seraient la première conséquence.
Dans la nuit du samedi au dimanche, des jeunes gens du village frappèrent à la porte. Ils étaient essoufflés, montant en toute hâte, prévenir les bergers mobilisables de descendre aussitôt : vers la fin de l'après-midi, on avait sonné le tocsin et on avait posé sur les murs de la mairie et de l'école les affiches de mobilisation.
Toute la journée du dimanche des hommes descendirent de tous les sentiers de la
montagne. Il en vint aussi par le col : des Français travaillant en Espagne et rentrant en France pour faire leur devoir. Ils s'asseyaient sans rien dire, demandaient du vin, regardaient dans le vague, un instant détendus par la tranquillité, le calme et la paix du site et du gîte, puis brusquement, ils vidaient leur
verre d'un coup, jetaient la monnaie sur la table et partaient d'un pas morne sans se retourner. Phine, qui n'était pas sentimentale cependant, avait les larmes aux yeux en les voyant descendre vers un tel destin. Combien remonteraient et s'arrêteraient à l'auberge à l'heure du retour ?
A la tombée du jour, un jeune homme entra, demanda une absinthe qu'il avala d'un trait, puis une seconde. Il portait une casquette à carreaux avec une longue visière cassée au milieu, des chaussettes de soie et des souliers bas en cuir jaune ; la cravate était verte avec des pois rouges. Il ne parlait pas patois, mais un étrange français, mélangé de mots d'argot avec un accent faubourien de grande ville. Il s'était assis dans un coin sombre et restait là, crispé, semblant réfléchir. Quand il
fit tout à fait noir, il se leva, ouvrit la porte et resta un instant sur le seuil regardant à droite puis à gauche comme s'il hésitait puis, ayant haussé les épaules comme s'il répondait à une question qu'il se posait intérieurement, il partit vers la gauche. Phine, le voyant aller dans cette direction sortit, lui criant qu'il se trompait et qu'ainsi il allait en Espagne. L'homme se mit à courir et, montant toujours vers le col, disparut dans la nuit.
Le Lundi un cantonnier vint apporter des ordres à Firmin. Pendant le temps de la guerre
— c'est-à-dire deux mois ou trois mois au plus
— l'Administration abandonnait la route du Portalet sur laquelle d'ailleurs il n'y aurait aucune circulation ; on entretiendrait seulement les routes de la basse vallée. A cet effet les cantonniers du Portalet devaient descendre de suite pour remplacer leurs camarades mobilisés.
Phine et Firmin partirent le jour même.
En arrivant, Firmin alla prendre dans l'armoire son livret de mobilisation pour relire ce qui y était écrit. Il était de la classe 1888, service auxiliaire ; son fascicule portait qu'à la mobilisation il devait attendre dans ses foyers son ordre d'appel. La guerre serait finie bien avant que vint son tour de servir.
Après ces premiers départs massifs, le village, comme un malade anémié par des hémorragies abondantes, vivait au ralenti.
Le martèlement du marteau sur l'enclume qui était le premier bruit matinal avait cessé : le forgeron étant parti dès le dimanche matin.
Le soir, on n'entendait plus les conversations des hommes sortant des auberges qui restaient vides.
La route était déserte, autos et attelages ayant été réquisitionnés. Il était d'ailleurs interdit d'aller au village voisin sans un saufconduit du maire. A la tombée du jour, des charrettes en travers des rues formaient des barricades qu'il était interdit de franchir.
Tout de suite, il n'y eut plus de sucre chez l'épicier. Le sel manqua peu après, puis le café. Heureusement, en Ossau, chaque maison a du blé, du lard, du confit, des pommes de terre, des légumes au jardin, le lait des vaches à l'étable, un et le plus souvent des porcs à l'écurie ; bien pauvre est celui qui ne peut se suffire à lui-même pendant quelques semaines ou quelques mois.
On ne vit plus d'or et bientôt plus d'argent. Le percepteur payait avec des billets en papier de cinq et de dix francs. Les paysans refusèrent d'abord cette monnaie ; ils finirent par accepter quand ils virent que le seul choix possible était entre cela ou rien. Ils s'en débarrassaient toutefois quand ils pouvaient en changeant ce papier contre du métal, des sous de bronze qu'ils thésaurisaient. Par tradition orale le souvenir des assignats les rendait hostiles à toute monnaie qui n'était pas de métal.
Les bruits les plus divers et les plus absurdes couraient.
Un gendarme, disait-on, ayant remarqué la longueur des pieds de deux bonnes Sœurs sur le quai de la gare de Buzy les avaient interrogées ; comme elles se troublaient, on les avait fouillées et on avait découvert que sous cet habit monastique il y avait deux officiers allemands qui s'apprêtaient à faire sauter les
aiguilles de manœuvre et à interrompre la circulation entre Pau et la vallée. On les avait fusillés.
L'Evêque de Lourdes était parti en automobile avec trois millions en or qu'il portait aux Allemands. On avait arrêté la voiture, confisqué l'or et l'Evêque allait passer en Conseil de guerre.
Les soldats du 18me étaient partis la fleur au fusil en chantant. Sur les wagons ils avaient inscrit Pau-Berlin, aller et retour : trois semaines.
Un ordre du Préfet fit lacérer toutes les affiches de bouillon Kub qui contenaient, paraît il, de mystérieux renseignements pour les espions ; l'épicier, craignant d'être compromis, alla, une nuit, jeter au Gave les comprimés de « Poule au pot » qui lui restaient.
Les journaux apportaient des nouvelles réconfortantes. L'ennemi déjà n'avait plus de vivres : des zouaves avaient fait des prisonniers en leur montrant des tartines. Les Allemands étaient mal équipés : les brodequins de certains prisonniers avaient des semelles en carton.
Avec angoisse, on parlait d'une grande bataille qui se préparait et déciderait de la guerre. Dans une ruée farouche, des centaines de milliers de combattants s'affronteraient et se précipiteraient les uns contre les autres. Il y aurait des hécatombes et le vaincu, épuisé, ne pourrait plus qu'implorer une paix sans condition. Nos hommes, vainqueurs — cela ne pouvait faire de doute —, feraient une entrée triomphale à Berlin, puis rentreraient dans leurs foyers pour l'hiver.
Fin août, une dépêche affichée à la mairie annonça que la bataille avait eu lieu. Nos troupes avaient été héroïques, mais avaient dû céder devant la supériorité en nombre et en matériel de l'ennemi. Simple repli stratégique d'ailleurs sur des positions prévues et préparées à l'avance.
De nouveau ce fut l'attente, une attente plus angoissée encore qui ne laissait même pas à ces paysans et à ces paysannes le courage de travailler.
Au début de septembre, une nouvelle dépêche annonça cette fois une grande victoire. La lucidité et le sang-froid du maréchal Joffre avaient gagné la bataille et la guerre. Non seulement il avait arrêté l'ennemi sur la Marne, mais il l'avait vaincu, obligé à fuir en déroute. Nos armées n'avaient plus devant elles que des fuyards.
Chacun se reprit à respirer et se remit au travail, d'autant plus que l'Intendance commençait à réquisitionner le blé, les haricots, le bétail.
En même temps, une autre nouvelle mit, presqu'autant que celle de la victoire, le village en effervescence. Les femmes des mobilisés qui n'avaient pas les ressources nécessaires pour vivre toucheraient une allocation en argent tout le temps de leur absence. En fait, bien rares étaient, parmi ces paysannes, celles qui vraiment ne pouvaient tirer de leur bien de quoi vivre. Les vieux avaient repris le travail, les jeunes s'y étaient mis plus tôt. Les femmes s'étaient habituées à faire des travaux
jusque-là réservés aux hommes. Les voisins s'aidaient entre eux et la tâche générale du village s'accomplissait presque comme si tous les hommes avaient été là.
Mais une ou deux femmes plus âpres au gain s'étant fait inscrire, toute une ère de querelles, de réclamations s'ensuivit. Telle demandait son inscription si elle voyait sa voisine sortir du bureau du percepteur. Finalement toutes les femmes des mobilisés furent sur la liste des « locations » et il n'y eut plus de jalousies que celle, secrète, des femmes de non mobilisés.
Avec honnêteté d'ailleurs, l'allocataire faisait de sa « location » deux parts, l'une grossissant les économies, l'autre envoyée au mobilisé par petits mandats.
L'après-midi de la Toussaint, le valet commun annonça qu'un convoi de réfugiés du Nord allait arriver le même soir. Le Maire comptait sur le bon esprit de la population pour recevoir comme elles le méritaient ces malheureuses victimes de la
guerre, arrachées à leurs foyers. En attendant des instructions qui étaient annoncées et arriveraient sous peu, la population était conviée à leur donner l'hospitalité, chacun prenant selon ses moyens, un, deux, trois réfugiés qui aideraient dans les
travaux. Rendez-vous le soir à six heures à l'arrivée du train.
De trois wagons, les autres ayant été égrénés dans les gares précédentes, une foule lamentable descendit : des enfants apeurés se serrant contre les jupes de leurs mères, des vieilles femmes ayant sauvé leur chat, une grosse mémère tenant dans ses bras une pendule. Une gamine avait emporté son serin dans une cage et son frère soufflait à perdre haleine dans une trompette de bazar.
Dans la pénombre du quai éclairé seulement par les quinquets à huile, ce fut comme un marché d'esclaves. Chacun choisissait à sa convenance, toisant de l'œil, estimant le rendement possible de celui ou de ceux dont il allait prendre la charge. Il y eut des hésitations, des marchandages, des échanges. Le manque de main d'œuvre au village activait cependant les pourparlers, celui qui aurait trop hésité et attendu risquant de ne plus rienavoir.
Bientôt, il ne resta plus au bout du quai qu'un triste déchet des mères trop chargées de famille, des infirmes incapables des lourds travaux de la culture, une femme entre deux âges qui n'avait aucun papier, qui ne pouvait même dire son nom et qui, sans doute, rendue demi-folle par la canonnade, répétait inlassablement : « Bada-boum, bada-boum, bada boum ». Le maire les envoya à la mairie où on leur prépara un dortoir sur la paille.
Il y avait aussi un vieux couple d'aspect d'autant plus convenable qu'au moment du départ, il s'était endimanché et, pour les sauver, avait mis ses plus beaux vêtements, lui sa redingote avec le pantalon rayé, le chapeau Cronstadt et les bottines à élastiques, elle un mantelet et une capote garnie de jais. Aucun paysan ne voulait, pour vivre sous son toit, de ces gens pour qui, sans doute, il aurait fallu se mettre en frais et se gêner. Finalement, quand, d'une petite voix triste, l'homme eut expliqué qu'il était retraité comme receveur des douanes, le brigadier douanier s'offrit à le prendre, flatté d'avoir à son foyer un supérieur qui, au surplus, avait peut-être d'utiles relations.
Phine, ayant d'un coup d'œil inspecté le lot, avait jeté son dévolu sur deux grandes filles qui n'avaient pas d'enfant derrière elles. Vite, sans attendre, sans rien demander, elle les fit sortir de la gare et les emmena chez elle : ainsi, tout en faisant son devoir, elle aurait à la maison deux robustes servantes pour leur seule nourriture.
On se mit à table. Phine, comme à l'habitude, servit elle-même les convives et remplit, jusqu'aux bords, leurs assiettes de légumes arrosés d'un peu de bouillon. Devant cette bouillie épaisse, les filles hésitèrent, en mangèrent la moitié, laissèrent le reste. Quand Phine leur versa ensuite un plein verre d'eau fraîche, elles firent la grimace. La maîtresse de maison découpa ensuite le lard chaud : elles en acceptèrent seulement une tranche pour deux et Phine fut toute heureuse de leur voir si peu d'appétit. Après le lard, elles semblèrent attendre quelque chose qui ne vint pas.
Elles essayaient de causer, mais la conversation n'était pas facile car les filles ne parlaient guère que le flamand avec à peine quelques phrases de français et naturellement pas un mot de béarnais. Elles montrèrent leur laisser-passer qui portait leur état-civil : Van der Putte Herminie, née à Hondschoote, le 31 janvier 1890 et Van der Putte Fredericka, née à Hondschoote, le 10 août 1891. Ce nom de Putte publiquement et officiellement donné choqua Phine qui, d'autre part, estimait qu'Herminie et Fredericka n'étaient pas des prénoms de chrétienne.
Elles firent aussi comprendre qu'au moment du départ, les obus commençant à tomber sur le dernier train d'évacuation déjà presqu'au complet, toute leur famille n'avait pu prendre place dans le même wagon. Elles, les aînées, étaient mon tées dans un autre compartiment. En pleine nuit, sans prévenir, le train avait été coupé en deux et elles ne savaient où leurs parents avaient été dirigés.
Le lendemain, à six heures et demie, quand Phine alla les réveiller, elles dormaient
à poings fermés et il fallut aller les chercher deux fois pour les voir descendre enfin à huit heures. Sur la table, Phine avait préparé le déjeuner habituel : la miche et un bol de petit lait sans sucre. Elles goûtèrent le lait et laissèrent le bol plein, se contentant d'un petit morceau de pain.
Phine, pour les occuper, mit devant elles les légumes qu'elle venait de chercher au jardin pour la soupe de midi. Elle leur donnades couteaux, puis partit pour aérer les écuries. Quand elle rentra, elle leva les bras au ciel : les deux filles avaient fait des épluchures d'un centimètre d'épaisseur.
Ensuite, elle alla prendre la corbeille dans laquelle elle mettait le linge, les bas et
les chaussettes à repriser, plaça du fil, de la laine et des aiguilles devant elles et monta au grenier. En passant devant la chambre des filles elle eut la curiosité d'entrer : la chambre n'était pas faite. D'une valise entr'ouverte, sortait du linge comme jamais Phine n'en avait vu et comme jamais même elle ne s'était douté qu'il en existât : des chemises vertes, roses, jaunes avec de la dentelle, laissant la gorge et les bras nus, des pantalons qui, froissés, tenaient dans la main, des bas fins, mais
élimés, percés de trous et qui n'avaient jamais été raccommodés. Il y avait des corsages et des jupes comme en portent seulement les femmes de rien à Pau.
Elle descendit : l'une des filles, en riant, avait passé au-dessus de sa robe une chemise de Phine en dure toile de lin et toutes deux se gaussaient.
Alors, elle donna à l'une un balai, à l'autre un savon et des mouchoirs à laver; la première envoya, à grands coups, la poussière dans toutes les directions sans arriver à la sortir ; la seconde, au bout de dix minutes, s'était trempée comme un canard et avait inondé d'eau savonneuse la moitié de la cuisine.
A midi, elles ne mangèrent également qu'une moitié d'assiette de soupe, puis la dernière cuillerée avalée, elles sortirent, se promenant dans la grande rue du village, se poussant du coude et riant aux éclats quand elles rencontraient des jeunes gens.
Quand elles revinrent à deux heures sonnant, Phine s'était décidée, puisqu'apparemment elles n'étaient bonnes qu'à cela, à leur faire garder le bétail. Les laissant dans la cour, elle alla ouvrir la porte de l'écurie. Dès que la première corne apparut, elles se sauvèrent en criant et se barricadèrent dans la maison : elles avaient peur des vaches !
Le soir, Phine prépara un plat de pâte, non pas de pâte ordinaire à l'eau, mais de
pâte au lait comme lorsqu'on veut régaler un invité. Les filles intriguées, regardèrent les préparatifs, le chaudron de cuivre rempli de farine de maïs, celle-ci devenant peu à peu rousse sans toutefois brûler, étant continuellement brassée par une grande cuiller de bois.
Quand Phine jugea la couleur convenable, elle versa dans le chaudron un litre non de petit lait mais de lait non écrémé, puis elle remplit la soupière et servit.
Curieuses, les deux filles goûtèrent unepremière cuillerée, avalèrent, en se forçant une seconde, puis une autre mais ne purent aller plus avant. Ayant bu un verre d'eau, elles partirent se coucher.
Le lendemain matin, quand elles descendirent de leur chambre, elles sortirent sans même toucher au bol de petit lait. Un quart d'heure plus tard, le valet commun venait prévenir Phine et son mari que le maire les attendait à la mairie. Phine changea de mouchoir de tête et ils partirent. Dans le bureau, ils trouvèrent le maire, les deux filles et le vieux monsieur retraité qui servait d'interprète.
Les filles expliquèrent qu'on les avait reçues avec de très bonnes manières, donné une bonne chambre quoique bien froide et avec des draps bien durs, mais que, sauf le respect qu'elles devaient à Monsieur le Maire, on les avait laissé crever de faim.
Phine devint folle de rage.
— Crever de faim ! Crever de faim... Je les ai nourries comme si elles étaient de la
maison. Crever de faim avec une bonne soupe au lard et de la pâte au lait non écrêmé à discrétion ! Crever de faim quand elles avaient eu à manger ce que tout le monde mange au village !
Le Maire essaya d'arrêter Phine : il était blasé ayant eu depuis la veille vingt-cinq réclamations du même genre sur trente familles hébergées. Mais Phine poursuivait encore.
— Crever de faim... Elles l'auraient mérité. Des fainéantes qui n'avaient pas voulu
travailler, pas même balayer. Crever de faim... des propres à rien qui, à vingt-cinq ans, n'étaient pas capables de garder les vaches, comme le fait en Ossau une gamine de douze ans...
Elles s'expliquèrent. Si elles n'avaient pas fait ce qu'on leur demandait, ce n'était pas mauvais vouloir, mais ignorance. Elles étaient trieuses de charbon et en dehors du tri de charbon, elles ne savaient rien faire.
Dans les bennes qui amènent à la surface ce qui est extrait du fond, il y a, pour certaines mines du moins, de la terre ou des pierres mélangées à la houille. On verse la benne sur des trémies et des femmes ou des filles avec de longs râteaux tirent à elles les détritus incombustibles, tandis que le charbon est entraîné vers des wagons. Dans ces tas de détritus eux-mêmes il y a encore des morceaux de charbon entraînés par le même coup de râteau.
Une tolérance de la mine permet aux enfants d'aller comme des petits chiffonniers, fouiller dans ces détritus et ils rapportent à la maison des seaux de charbon que la mère utilise dans le fourneau ou qu'elle vend. Quand ils ont l'âge légal du travail, ils entrent au service de la Mine : les garçons comme apprentis chercheurs, poussent les wagonnets, les filles comme trieuses prennent le râteau.
Chez les Van der Putte il y a six personnes au foyer : le père et la mère, les deux filles, un garçon plus vieux et un plus jeune. Sur six cinq travaillent à la Mine ; seule la mère vaque aux soins du ménage. Chaque quinzaine, il rentre ainsi de 250 fr. à 300 fr. à la maison.
On ne fait pas d'économie. Des caisses d'assurance et d'assistance, des crêches, des hôpitaux prévoient à tous les imprévus, aux accidents, aux maladies, aux naissances. On dépense l'argent facilement comme on le gagne. Le matin, au premier déjeuner, il y a sur la table du café au lait avec du beurre, à midi de la viande et des légumes, en rentrant du travail du café et du beurre, le soir de la soupe et du poisson. Comme boisson, de la bière à tous les repas et à midi du café avec de l'eau-de-vie pour les hommes.
Les filles laissant à la maison presque toute la paye, produit de leur travail, n'entendent pas travailler au ménage par-dessus le marché. A quoi bon d'ailleurs ? Elles usent le linge et les bas jusqu'à ce qu'ils tombent en loques ; le temps qu'elles mettraient à les ravauder leur rapporterait moins que quand elles le passent à la mine.
— Alors, conclut Phine, je vais travailler pour les nourrir tandis qu'elles ne feront rien ?
— On ne peut tout de même pas, concluent les filles, nous forcer à manger cette
pâte dont, chez nous, le chien ne voudrait pas ?
Phine a raison. Les filles ont raison. Le Maire a raison quand il renonce à concilier
ces inconciliables. La faute n'est à personne qu'à la guerre qui a mélangé deux états sociaux aussi divers.
La situation s'envenima rapidement. Parmi les réfugiés, il y avait un beau parleur qui parlait de réunir une délégation pour aller porter au Préfet la plainte des Prolétaires réfugiés contre les Paysans capitalistes. Les Paysans menaçaient de sortir avec leur fourche toute cette racaille de leurs maisons.
L'effervescence fut à son plus haut point quand arriva la circulaire annoncée. Le Préfet informait que, désormais, les réfugiés toucheraient une allocation. La situation était ainsi renversée. Il n'était plus question pour le paysan de donner, mais de vendre ; le réfugié devenait un client pour le lait, le beurre, les légumes et tous les produits de la terre. Le calme revint immédiatement.
Herminie et Frédéricka avaient cependant compris qu'elles ne pourraient vivre sous la tutelle rigide de Phine. Sous prétexte d'aller demander à la Préfecture de faire des recherches pour retrouver leurs parents, elles profitèrent du premier versement de leur allocation pour aller à Pau. Le Maire donna un sauf-conduit. Elles emportèrent leur valise en se cachant de Phine et, celle-ci qui s'en était aperçue, ne fit pas semblant de l'avoir remarqué.
Le soir, elles ne rentrèrent pas comme elles l'avaient promis. Phine ne signala pas leur absence au Maire qui n'eut pas l'air de s'étonner de ne plus les voir toucher leur allocation : il y avait toujours assez de ce gibier dans sa commune. Un jour de marché, un homme du village entrant dans une auberge près des casernes de la Haute-Plante y rencontra les deux Van der Putte : elles servaient à boire à la clientèle.
La guerre cependant ne finissait pas. Au front, les hostilités traînaient en longueur et il fut bientôt certain qu'elles dureraient tout l'hiver jusqu'à l'offensive, décisive celle-là, du printemps. Pour la préparer, le haut commandement venait d'instaurer une tactique nouvelle et géniale. Sur les points les plus divers du front, des offensives isolées étaient brusquement déclanchées dans les Vosges, en Argonne, en Champagne, dans les Flandres.
Parfois la surprise réussissait et le lendemain le communiqué annonçait la prise d'un bout de crête au Linge, d'une cave à Vauquois, d'un élément de tranchée à Craonne ou d'une écluse sur l'Yser.
D'autrefois, l'attaque ne réussissait pas : la vague d'assaut, arrêtée par des barbelés in tacts ou fauchée par les mitrailleuses tournoyait indécise, comme prise dans un cyclone, puis refluait sur la tranchée de départ, laissant des morts et des blessés sur le terrain. Ce jour-là, le communiqué ne signalait « rien dans le secteur ».
Mais ainsi un double résultat souligné par les journaux était atteint : le moral des troupes auquel l'inaction aurait porté atteinte était maintenu à un niveau fort élevé et l'ennemi peu à peu était décimé. « Je les grignotte », avait dit Joffre. Les lettres du front n'apportaient aucune nouvelle sur les opérations, d'abord parce que c'était défendu, ensuite parce que le soldat ne voyait que son coin de tranchée et le village en ruines où il était au repos. Hors de son étroit secteur, il ne savait lui-même rien que par les journaux.
Au cours de l'été 1915, une lettre passa de main en main dans le village. Baylaucq, le boulanger, écrivait à sa femme qu'on allait accorder des permissions. Les premiers furent choyés, fêtés ; on allait en groupes les chercher puis les reconduire à la gare. Puis il y en eût d'autres, puis d'autres et on n'y fit pas plus attention qu'aux permissionnaires du dimanche en temps de paix. Le lendemain de son arrivée, le soldat reprenait ses vêtements civils et se mettait aux travaux que les vieux et
les femmes n'avaient pu faire. Une heure avant le départ, il remettait son uniforme pour aller reprendre son autre travail, son travailde soldat là-bas.
Sa grande satisfaction de permissionnaire était de ne voyager, par principe, que dans les compartiments de première classe, même quand, en plein hiver, ses prédécesseurs en avaient cassé tous les carreaux.
Au printemps de 1916, les batailles de Verdun ayant saigné à blanc l'armée, Firmin, convoqué à Pau devant un conseil de révision, fut versé, de l'auxiliaire, dans la territoriale de l'armée active.
Quelques mois plus tard, il fut appelé.
Avec les hommes de la même classe habitant le village, il devait rejoindre le dépôt de son régiment à Bordeaux.
Phine n'en eut ni chagrin, ni crainte. L'idée de la séparation la laissait indifférente et la pensée du danger ne l'effleura même pas : les journaux disaient que les territoriaux comme lui n'étaient pas versés dans les unités combattantes, mais employés à des travaux loin des tranchées.
Elle lui avait tricoté deux paires de chaussettes qu'elle mit avec un gilet de laine et deux saucissons dans sa musette de cantonnier. Elle emplit elle-même sa gourde de vin de Jurançon et, ayant ainsi fait tout ce qui devait se faire, elle le conduisit à la gare. Ils se quittèrent l'œil sec, ne trouvant rien à dire, gênés et au fond impatients d'entendre le coup de
sifflet.
En quittant la gare, elle fit un détour, entra chez le percepteur, frappa à la porte du bureau, attendit son tour parmi la cohue qui se pressait et s'enquit :
— Mon homme vient de partir à la guerre... Quand est-ce que je pourrai toucher ma « location ? »
Maussade, le fonctionnaire la dévisagea.
Elles étaient toutes les mêmes, toutes aussi âpres à quêter cette somme ; il l'interrogea sur sa situation.
— Ah ! vous êtes la femme du cantonnier ?
Mais alors, vous n'avez pas droit à l'allocation.
Phine devint blême. Elle ne toucherait pas sa « location » comme les autres ? Le percepteur poursuivait :
— Votre mari étant fonctionnaire touchera son traitement comme s'il était en fonctions.
Sur ce traitement, il vous enverra une part ou il vous la délèguera. A vous de vous arranger avec lui.
— Mais, Monsieur le Percepteur, les autres, elles tirent de l'argent de leurs biens comme si l'homme était là et elles touchent en plus leur « location ». Puisqu'on m'a pris le mien comme les autres, il faut me donner aussi la « location » en plus, comme aux autres. Ah ! ce qu'il y a du chagrin pour le pauvre monde...
Et elle se mit à pleurer, de vraies larmes, des larmes sincères. Pour la première fois qu'elle avait fait un rêve, il s'envolait.
Finalement, Firmin lui donna délégation de moitié, mais elle resta indignée d'une
telle injustice : la République l'avait volée.
Suite../..
 Sources Sources
- L.Le Bondidier, de l'Académie de Béarn, édition de l'Échauguette, Château fort de Lourdes, 1939
|

